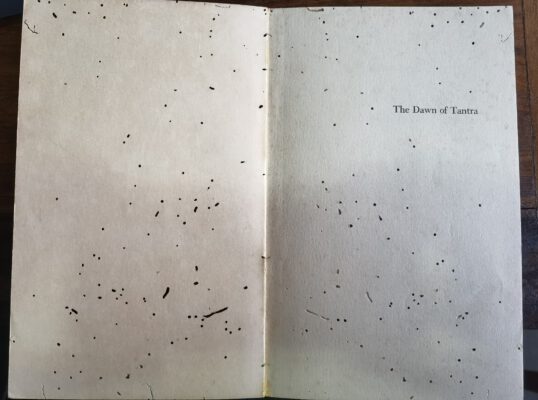Een koan donc. J'en ai souvent entendu parler, de ces mystérieuses énigmes du zen qui sont censées faire sortir l'esprit du rationnel pur et ouvrir de nouvelles formes de compréhension. J'ai décidé de ne pas lire grand-chose à ce sujet et de ne pas demander à d'autres de le faire. Je voulais en obtenir une d'un maître zen. Pendant le doksan, il m'a posé quelques questions sur moi. Nous avons fermé les yeux, il a souri et m'a dit d'imaginer une forêt dans laquelle coule un petit ruisseau. Quand j'entre dans le ruisseau, comment puis-je effacer le son du clapotis ? Il m'a dit de ne pas y réfléchir intellectuellement, mais plutôt de porter le koan avec moi, de l'emporter en méditation, de voir ce qui se passe et de revenir pour en parler.
L'image a immédiatement agi en moi. Je me voyais dans la forêt, debout dans le ruisseau, la métaphore imagée du fleuve, d'un courant du cosmos, l'eau comme élément originel, l'entrée dans le flux des choses et du temps, la forêt comme lieu de paix, de stabilité, de nature. Les bruits de la forêt, les oiseaux, le clapotis, le clapotis de ses propres pieds dans l'eau, le bruissement et le son des pas. Où mon chemin me mène-t-il ? Tout est en mouvement, je suis maintenu dans la nature, j'agis et je marche, tout change, et pourtant tout reste tel quel. Je pourrais réfléchir très longtemps à cette image, la rapporter à ma vie, aux changements que je vis, à la question du sens de la vie et à la simplicité de la réponse dans la nature et la contemplation. Mais il me semble que ce n'est que le début - se référer à soi-même est un premier pas.
Revenons à la question : pourquoi devrais-je essayer de couper le son ? Y a-t-il quelque chose de faux dans le son de l'eau, son murmure et son clapotis, les pas dans le ruisseau ? Qui a dit que ces sons étaient faux ? Ils ne dérangent pas, ne détournent pas l'attention, ils font partie de la marche. Le son de la marche s'arrête si je m'arrête, mais le ruisseau continuera de bruire, les oiseaux de gazouiller, les feuilles de bruire dans le vent. La question du koan est-elle si banale ? Ou implique-t-elle quelque chose qui peut être remis en question ? Peut-être faut-il remettre en question l'hypothèse selon laquelle le silence est préférable. Alors pourquoi le silence ? Dois-je réfléchir à la manière d'arrêter mes actions, de me mettre en silence, en méditation, et de m'ouvrir au vide et à la forme ? Il y a probablement déjà là quelque chose de pertinent.
J'oppose donc à la riche métaphore de la marche dans le ruisseau dans la forêt quelque chose : une contemplation intérieure, une réflexion sur le vide et la forme, une immobilité et une prise de conscience. Les sons extérieurs, les images, les impressions sensorielles s'évanouissent à l'intérieur ; ce sont des projections à l'intérieur d'une vision qui ne correspond pas du tout à la réalité - car je ne suis pas du tout dans le ruisseau, mais je suis en train d'écrire sur mon ordinateur ou je suis assis en méditation. J'ai donc affaire à une image mentale qui invite à la méditation, et la connaissance que je dois en tirer n'est pas celle de la résolution de problèmes. Je peux aller plus loin ici, je pourrais maintenant me plonger dans la structure de la pensée, du langage, des images - la sémiotique. Comment la question, en tant que phrase, se rapporte-t-elle à la représentation, et quel type d'action suscite-t-elle pour produire quel type de connaissance ? Ce serait un beau projet pour un séminaire - y réfléchir pendant quelques semaines, dans les traditions de la philosophie occidentale. Mais ce ne sera certainement pas le but du koan que de m'y perdre. Le koan doit permettre de sortir de ce labyrinthe de la pensée rationnelle.
C'était une belle petite excursion - l'écho de mes études de philosophie. J'essaie donc un autre chemin, celui des Upanishads, de l'océan originel profond dans lequel se déversent les sept fleuves de l'existence, mais d'où s'extrait en premier lieu le purusha lui-même et où tout naît de ses yeux, de ses oreilles, de sa langue, de sa bouche et de son nez, de ses cheveux et de ses articulations. Plonger donc dans les conditions de ma propre existence, de mon corps, de ma respiration, de ma pensée et de mes sentiments. Intervenir dans le flux, mouiller mes pieds avec l'eau, percevoir les sens en tant que sens, les distinguer en tant qu'externes et internes. Et puis la tâche, la question : comment puis-je faire taire le son ? Et pourquoi voudrais-je le faire ?
Pourquoi devrais-je m'occuper d'une telle question ? Elle me sert déjà assez bien à faire étalage de ma vanité, à démontrer dans quelles écoles de pensée je me déplace confortablement. Pourquoi suis-je assis dans un centre de méditation zen depuis deux semaines et essaie-je de m'engager dans le zen, d'apprendre quelque chose d'un enseignant par le biais d'un koan ? Qu'a-t-il à me montrer ? Où peut mener le chemin ? Le koan est-il un outil pour entrer en dialogue et ma tentative de l'approcher par l'écriture est-elle un subterfuge - une tentative timide d'arracher la rencontre ?