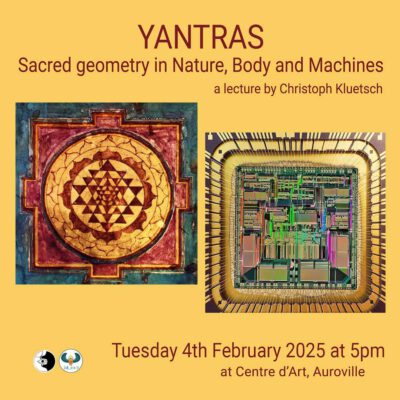Schopenhauer, qui était un grand admirateur des Upanishads, a écrit un petit livre "Sur la racine quadruple de la proposition de raison suffisante" (1847). Il identifie 4 formes de causalité, par exemple petite cause - grand effet, ou grande cause - petit effet, etc... Cela m'a fasciné parce que cela offre une compréhension plus large que le modèle purement scientifique, qui suit toujours en fin de compte la loi de conservation de l'énergie. Par exemple, si quelqu'un déclare la guerre, c'est un acte relativement simple (petite cause) et un effet énorme. Je me demande comment cela se rapporte à la science historique. Là aussi, il y a la notion de relation de cause à effet. Dans la science historique, les choses se produisent toujours pour une raison. Mais cette raison est souvent disproportionnée par rapport à l'effet.
Narratif
Si nous nous écartons donc du modèle rigide de la causalité simple, l'histoire n'est plus une suite rationnelle, causalement nécessaire et univoque d'événements enchaînés, mais un réseau de différents éléments dans un schéma stimulus-réponse. Deleuze a introduit le concept de rhizome, qui convient ici. Tout est en quelque sorte relié à tout par différents et innombrables nœuds. Le sac de riz qui tombe en Chine et provoque un effet papillon en est un exemple éloquent.
Nous voyons cependant dans les analyses postmodernes et poststructuralistes des événements historiques des tentatives de ne pas réduire les événements de manière causale, mais de les examiner sous l'angle de leur réseau de relations. Des récits possibles apparaissent, dont l'un est aussi valable qu'un autre, tant qu'il s'en tient aux faits. On dit que tous les êtres humains sont connus les uns des autres au septième degré. C'est une statistique, mais qui montre la complexité. Quelqu'un a inspiré à un autre d'écrire quelque chose qui a été lu par une troisième personne, puis récité à une quatrième, qui a réagi et déclenché chez une cinquième une action qui est considérée comme un événement historique. Cela peut être très arbitraire et contredire rapidement les récits linéaires des livres d'histoire. Néanmoins, cela n'est pas forcément faux.
Une telle compréhension du monde, dans laquelle tout est lié à tout et où une explication monocausale est impossible, n'est pas seulement une critique du rationalisme et de la rigueur des sciences. C'est en fin de compte la reconnaissance d'un lien qui dépasse la compréhension humaine. Elle est en fait spirituelle, car elle reconnaît une force complexe. Dans les Upanishads, cette force est chantée comme le Soi. Chez les penseurs postmodernes, cela relève plutôt de l'immanence, ou d'un matérialisme tolérant, qui ne se réduit finalement pas à un atomisme, mais doit plutôt être pensé comme une opposition au dualisme. Tout est matière, c'est-à-dire que tout est une forme d'être - c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul soi. La boucle est bouclée.
La raison dans l'être
Le mal fondamental était l'exagération excessive du mental et de la raison et l'ignorance de l'intuition. Dans les premières Upanishads, la pensée mystique et la pensée rationnelle ne sont pas séparées jusqu'à présent. Nous y trouvons une vision intuitive du soi, une reconnaissance des forces d'action qui ne sont pas irrationnelles, mais qui ne sont pas non plus purement rationnelles. C'est une pensée holistique que le postmodernisme a intuitivement ravivée dans sa lecture matérialiste, marxiste et psychanalytique quelque peu décalée.