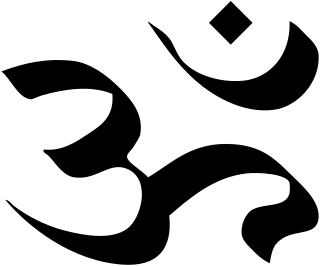Mimesis - Rasa - Représentation - Expression - Pensée
Antiquité classique
J'essaie depuis des dizaines d'années d'éviter les écueils de l'éducation.r de la théorie occidentale de l'art et de l'éviter. J'ai ensuite traîné pendant de nombreuses années dans les contrées de la théorie des médias, où j'ai réfléchi à toutes les formes possibles de représentation, à la nature de l'information et aux possibilités d'interaction. Il m'a fallu beaucoup de temps pour m'approcher du sublime, jusqu'à ce que j'arrive enfin en Inde.
Dans l'Antiquité classique, il existe deux termes importants qui se rapportent à l'art : Mimesis et Aisthesis. La mimesis est le principe de l'imitation. Platon disait que si nous imitons quelque chose qui est de toute façon un mensonge, car la Ombre sur le mur de la grotte ne sont que des apparences, l'imitation n'est donc que le mensonge du mensonge, et donc dangereuse. Aristote était plus 'moderne', pour lui la mimésis est le fait de vivre des drames, une catharsis est possible dans l'émotion et l'expérience de la résolution des conflits, nous pouvons ainsi apprendre, voire guérir et grandir.
Le deuxième terme, l'aisthèsis, traite un peu plus en profondeur de la perception elle-même. Comment nos sens perçoivent-ils ? Qu'est-ce qui plaît à nos sens ? Quels sont les sentiments qu'ils suscitent ? Quand quelque chose est-il sublime ? Il s'agit ici de la structure de notre perception, c'est donc plus théorique.
Les deux concepts, mimesis et aisthesis, mènent généralement à des théories de la représentation : qu'est-ce qui est représenté et comment et comment nous le percevons ? Cela repose le plus souvent sur une relation sujet-objet, dans laquelle le sujet essaie de comprendre le monde comme un vis-à-vis, quelque chose qui est extérieur à moi et qui peut être compris par la perception et la mimesis. Le langage en tant que média, mais aussi d'autres formes de médias artistiques, sont utiles dans ce processus.
Mon problème fondamental était donc celui de la représentation, c'est-à-dire la représentation du monde pour le sujet, exprimée par un (autre) sujet. Depuis la Renaissance, le sujet est devenu plus exigeant, l'expression de soi, donc l'art comme expression de soi, a déterminé le concept moderne de l'art. L'art témoignait de la représentation d'un 'génie' artistique qui prononçait son point de vue individuel. Il s'agit d'une forme de représentation un peu plus complexe, mais la question de l'observateur d'art est restée fondamentalement la même : Que représente l'œuvre ?
Le 5e Veda
14-15 Il se dit alors : "Je vais faire un cinquième Veda sur le Nāṭya avec les Contes semi-historiques (itihāsa), qui conduira au devoir (dharma), wealth (artha) ainsi que la renommée, contiendra de bons conseils et une collection [de maximes traditionnelles], donnera des directives aux hommes de l'avenir ainsi que, dans toutes leurs actions, sera enrichi par l'enseignement de tous les ouvrages faisant autorité (śāstra) et fera une revue de tous les arts et métiers". https://www.wisdomlib.org/hinduism/book/the-natyashastra/d/doc202329.html#note-e-79660
Dans la période de quelques siècles avant et après l'ère commune, les textes centraux de la culture indienne, le āgama (le livre qui décrit la règle des temples au Tamil Nadu), Vāstu śāstra (principes de l'architecture), le Kāma-sūtra (qui décrit l'art de bien vivre), le Chitrasūtra (théorie des peintures et sculptures) et le Nāṭya śāstra (arts de la scène), le Viswakarma vastusästram (urbanisme) qui décrit le fondement de l'art comme une théorie de Rasa et bien d'autres.... Il n'a pas été possible jusqu'à présent de dater précisément tous ces textes.
S'y retrouver est encore plus compliqué que de s'orienter dans l'Antiquité classique. Je ne parle ici que des grandes lignes, pas des discussions techniques. Tous ces textes se réfèrent à la tradition des Vedas, et donc à l'enseignement de l'hindouisme selon lequel les textes des Vedas sont divins.
L'idée centrale est que Brahma, le créateur de l'univers, l'a créé pour faire l'expérience de lui-même. Le soi sous la forme d'Atman et en tant que soi conscient sous la forme de Purusha fait partie de Brahma, tout est Brahma, Brahma est tout. La prise de conscience de Brahma en l'homme par Purusha permet une connexion de notre moi avec Brahma. Cette connexion est notamment possible dans la méditation. C'est là que la conscience peut faire l'expérience d'elle-même et recevoir la vérité de Brahma. C'est ce qu'ont réussi à faire les rishis, qui ont transmis la vérité reçue dans les vedas. Le fait que cette connaissance soit divine sera plus tard rejeté par le bouddhisme.
Le point central de ce système de connaissances est que toute conscience est vibration, ce qui ne contredit pas la science moderne. Le site Vibration c'est la résonance, l'homophonie, MélangesDans sa forme la plus pure, cette vibration est la syllabe OM. C'est à cette expérience que tout se rapporte.
Bien sûr, il y a aussi les discussions sur le dualisme (dvaita) et le monisme (advaita). Mais l'advaita est la doctrine classique. Pour moi, ce qui a le plus de sens, c'est d'associer l'Advaita au concept de Immanence à l'aide d'une carte.
Ainsi, lorsque j'essaie de me plonger dans le monde de la théorie artistique de l'époque des Vedas, les notions d'advaita (monisme/immanence) et de vibration (conscience) sont centrales pour moi. Rasa (saveur, essence, humeur) est une vibration qui émane de cette structure de pensée.
Comme tout dans les écrits anciens du monde des Vedas, l'ensemble est hypercomplexe. L'esthétique est généralement très codifiée, tout a une signification, chaque mouvement (32 Aṅgahāras), chaque position des mains (24 mudras), chaque posture du corps (108 Karaṇas), couleur, proportion, relation, etc.... Tout cela a des significations bien définies. C'est le langage des dieux, les lois sont divines, il y a très peu de place pour l'interprétation. Ce qui est visible dans l'œuvre d'art est une mise en œuvre de ces principes. Ce n'est que lorsque ceux-ci sont exécutés dans la plus grande recherche de la perfection, avec dévotion et humilité, qu'ils ont rasa - essence, saveur, humeur. Car les dieux voulaient un objet de distraction qui serait audible et visible pour tous, et ils ont demandé à Brahmā de créer un veda qui appartiendrait à tous les groupes de couleurs. Brahmā créa Nāṭyaveda en combinant des éléments des quatre vedas existants. Après sa création, Brahmā demanda à Indra de faire exécuter le Nāṭyaveda par les dieux, mais Indra dit que seuls les sages qui connaissaient le secret des Vedas et avaient accompli leurs vœux étaient capables de le cultiver et de le pratiquer.
L'art indien 'traditionnel' n'a donc pas pour but de représenter le monde. Il ne s'agit pas non plus pour un artiste de s'exprimer. Il s'agit uniquement - dans la pure doctrine - de la réalisation du principe divin. Les descriptions de ce principe sont absurdement précises pour les Occidentaux. Si l'on croit qu'il s'agit de principes divins, la discussion s'arrête ici sur la raison pour laquelle il a précisément cette complexité. Sinon, la question se pose de savoir pourquoi tout a été consigné de manière si méticuleuse il y a 2000 à 4000 ans et pourquoi cette tradition s'est maintenue presque sans interruption jusqu'à aujourd'hui.
La source de l'art
Considérées en surface, les innombrables expressions de l'art aujourd'hui, c'est-à-dire dans ses médias, ses techniques, ses milieux culturels, ses formes d'expression, ses discours, sont d'une bigarrure déconcertante. L'art est l'art parce qu'il nous pousse à percevoir le monde différemment. C'est peut-être le plus petit dénominateur commun. Mais cela s'arrête là, car les visions du monde associées aux différentes formes d'art sont au maximum différentes.
La question est donc : qu'est-ce qui nous fait bouger ? Dans la mimesis, c'est une simulation qui peut être un pur mensonge ou devenir un espace de simulation productif. En tant que partie d'un discours philosophique, l'art peut nous amener à découvrir de nouvelles choses et à apprendre quelque chose sur notre propre nature. En tant que rasa, l'art prétend exprimer des vérités divines et nous aider ainsi à évoluer. Il n'est pas le témoignage d'un au-delà ou d'une histoire du salut, mais la manifestation de ce qui fait de nous des êtres humains, c'est-à-dire la manifestation de la conscience.
Dans un sens profane mais riche, cela signifie que l'esprit humain peut élargir sa conscience, la cultiver, l'entraîner, l'aiguiser. Ce développement de la conscience, chez l'individu, dans une culture, à une époque, se manifeste. Il est tout de même un peu absurde que tous les matérialistes et les capitalistes se précipitent à l'opéra pour y célébrer l'esprit de finesse qu'ils nient tant dans le quotidien des affaires.
Dans un sens spirituel, on pourrait penser qu'il est peu probable que mon niveau de conscience représente le point culminant du développement cosmique. Il serait donc possible d'imaginer que la conscience est plus grande que ce que nous associons généralement à notre cerveau à un niveau neuronal.