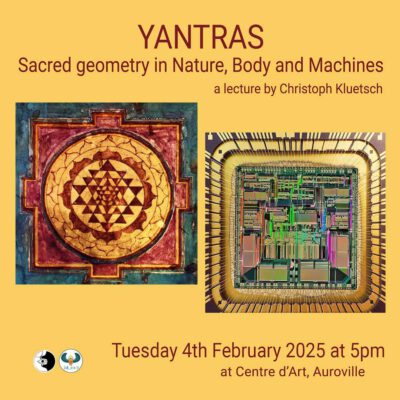Wors de la méditation, je regarde souvent ma pensée, je laisse les pensées aller et venir et j'essaie de ralentir la pensée. Les pensées vont et viennent, et souvent je ne comprends pas d'où elles viennent, ni pourquoi elles sont remplacées à un moment donné par une toute autre pensée. Quelle chaîne d'associations est à l'œuvre ? Ces chaînes de pensées semblent être le fruit du hasard, déclenchées par des expériences qui résonnent encore et qui sont retravaillées.
Cela me rappelle une pensée philosophique. Tout commence par une observation d'Henri Bergson. Il décrit le cinématographe, un appareil de la fin du XIXe siècle qui peut à la fois enregistrer des films et les lire. Le cinématographe enregistre de nombreuses images par seconde. Dans la théorie du cinéma, on parle de 25 images par seconde, prenons tranquillement ce chiffre. Donc 25 images par seconde. Lorsque tant d'images sont projetées l'une après l'autre, nous avons l'illusion du mouvement, c'est la magie du cinéma. Bien sûr, le mouvement n'est que dans les engrenages du cinématographe, le mouvement perçu des objets sur l'écran est un mensonge. Bergson est très clair sur ce point. Selon lui, le cinéma ne peut pas capturer la vie. Le Elan Vital ne se trouve pas au cinéma. C'est évident.
Walter Benjamin
Walter Benjamin était un peu plus optimiste. L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique s'en préoccupe. La photographie menace la peinture, peut-être... je n'en suis pas si sûr. L'aura se perdrait dans l'image reproduite techniquement, oui probablement... mais la réception de Benjamin s'arrête souvent là. Mais c'est ensuite que cela devient intéressant chez Benjamin, lorsqu'il parle du cinéma. Les 25 images par seconde libèrent les acteurs de la contrainte de la scène, le montage permet de créer d'autres narrations, l'espace, le temps deviennent des objets de création artistique. L'art utilise les possibilités du cinématographe de manière créative.
Gilles Deleuze
Gilles Deleuze pousse cela quasiment à l'extrême. Ses livres sur le cinéma sont légendairement incompréhensibles. Il commence par discuter du cinématographe de Bergson. Deleuze partage l'analyse de Bergson, mais l'erreur de Bergson est de ne pas être allé au bout de sa pensée. Les images individuelles, qui ne peuvent produire le mouvement que comme illusion, n'ont pas du tout pour fonction de copier la réalité, d'être vivantes. Elles sont, selon Deleuze, des pensées sur celluloïd. Le cinéma est une pure philosophie, la bande de film une pensée fixée. Nulle part ailleurs la pensée n'est aussi réellement fixée que dans le cinéma. Réfléchir sur le cinéma, c'est donc faire de la philosophie. C'est pourquoi les analyses de Deleuze sur les films sont si incompréhensibles. Si nous cherchons l'histoire derrière le film, nous nous trompons complètement chez Deleuze. Mais si nous considérons le film comme un médium philosophique, alors Deleuze a placé la barre très haut.
Lorsque je médite, il m'arrive de regarder mes pensées. Cela me rappelle la 'théorie du film' de Deleuze (il ne l'aurait probablement jamais appelée ainsi). Chez Deleuze, il n'y a pas de théorie, pour lui il n'y a que la pensée elle-même. Il y a apporté sa contribution, et comme il le dit lui-même dans son ABCDaire, on peut déjà s'estimer très heureux d'avoir trouvé une poignée d'idées nouvelles dans sa vie. Le mouvement de la pensée est une aventure, la philosophie en est la forme la plus pure. La théorie : sa mort. Lire Deleuze, c'est le penser autrement. Le référencer serait peut-être même une insulte.
En 2016, je suis allé en Inde pour la première fois, j'ai appelé le voyage ReadingDeleuzeinIndia2016, j'ai enlevé l'année, et c'est devenu le titre de ce blog. Pourquoi en Inde ? Parce que la façon de penser de Deleuze est en fin de compte profondément spirituelle. Il ne serait pas d'accord, mais cela lui ferait peut-être plaisir.